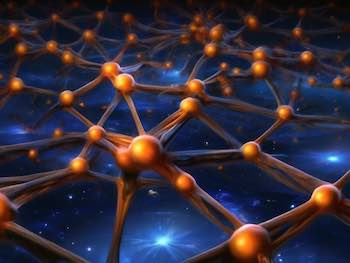Abstract: Le concept ‘causalité’ décrypté avec la Méthode Philosophique Universelle (UniPhiM). Ce concept-racine a été balayé de l’ontologie par Bertrand Russell, puis réanimé par différents modèles : contrefactuels, agentisme, probabilisme, transfert —avec en particulier la solution de Max Kistler en 2003, le transfert d’une grandeur conservée. Je montre comment l’UniPhiM fait coïncider l’invisibilité ontologique de la causalité avec la multitude de ses apparences téléologiques. La science utilise un langage pseudo-ontologique qui n’accède pas au réel en soi. Les équations ne renferment pas de principe de causalité mais ne répondent qu’à une partie des questions ontologiques. Je montre comment leurs sigles peuvent dissimuler le principe que nous cherchons.
Introduction
Pour montrer l’intérêt pratique de la Méthode Philosophique Universelle, soumettons-lui le concept ‘causalité’, très polémique aujourd’hui. C’est un concept-racine, « tout a une cause », mais actuellement éclaté entre la science, la philosophie, et le pragmatisme quotidien. La science se préoccupe surtout de la causalité ontologique, du “Comment?”. La philosophie s’intéresse à la causalité épistémique, au “Pourquoi?”. Enfin le pragmatisme mélange ces deux directions, quand la causalité devient opportunément un concept “utile”.
Peut-on unifier ces approches pour obtenir un concept universel ? C’est ce qu’a tenté Max Kistler dans ‘Causalité et lois de la Nature’ (2003). Une enquête magistrale et une véritable référence. Livre complété par un article plus concis et lisible pour un profane dans Intellectica en 2004. La causalité, en tant que concept-racine, est omniprésente et populaire autant dans la vie pratique qu’intellectuelle. Si l’on tente d’en chercher l’universalité par une méthode réductionniste, son développement doit ensuite en retrouver les différentes facettes et les coordonner.
La conservation d’une grandeur
La solution de Kistler est bien, dans un premier temps, une réduction : Il fait de la causalité le transfert d’une grandeur conservée de la cause à l’effet. La grandeur conservée en physique s’appelle ‘constante’ et correspond à l’énergie. Kistler ajoute une nécessité nomique1en rapport avec une loi : un fait est causalement responsable d’un autre fait s’il existe une loi de la nature en vertu de laquelle le premier détermine le second. Le travail de Kistler est épistémique ; il cherche à éviter les contradictions entre ontologie et téléologie. Sa solution séduit la physique, où l’énergie est une constante bien identifiée, mais comment l’appliquer aux sciences humaines ?? Comment retrouver nos causes et nos responsabilités quotidiennes ?
Kistler va confronter sa solution aux critiques. La tâche semble insurmontable. Engagé dans le fondamentalisme, comment associe-t-on des concepts-racine tels que ‘constante’ et ‘loi de la nature’, étrangers par essence ? Le premier a une définition mathématique, pas le second. Le concept ‘loi’ est-il vraiment affranchi de celui de ‘causalité’ ? La définition semble circulaire. Mais c’est un écueil quasi-inévitable pour les concepts-racine.
Dans une 1ère partie je résume la problématique qu’affronte Kistler et ses propositions. En 2ème partie je montre comment la Méthode Philosophique Universelle (Universal Philosophical Method ou UniPhiM) simplifie l’enquête et la fait aboutir à une théorie générale cohérente de la causalité. Les principaux éléments de l’UniPhiM sont résumés ici. Lecture conseillée pour comprendre la 2è partie. L’enjeu est à la hauteur. Une fois admis que les regards descendant/épistémique et ascendant/ontologique ne sont pas réductibles l’un à l’autre, l’élagage opéré par Kistler sur les définitions de la causalité n’est plus nécessaire. Au contraire il est important de préserver leur complémentarité. Nous récupérons nos causalités “utiles” en les gardant compatibles avec la “fondamentale”.
*
Partie 1: Causalité et lois de la nature
En 2003 Kistler exhume le cadavre de la causalité. Cette peau de chagrin est ce qui reste du passage de Russell, au début du XXè. Le remplacement de la terminologie causale par la fonctionnalité d’un modèle signe la maturité d’une discipline scientifique, disait Russell. Il invitait les philosophes à se passer définitivement du concept de causalité, avec trois arguments.
Les 3 coups de poignard de Russell
1) Anthropomorphisme désuet : la causalité c’est croire les processus dotés de motivation identique à la nôtre. C’est aussi voir des régularités là où il n’y en a pas. Croire que « une même cause macroscopique produit les mêmes effets » (Hume) c’est négliger de voir ses micromécanismes de près. En réalité un évènement macroscopique est si complexe qu’il est improbable qu’il puisse se reproduire à l’identique. La causalité de Hume ne tient que parce qu’il substitue le concept anthropique de ‘similaire’ à ’identique’. L’idée de “régularité” n’a pas de sens en ontologie, la similitude n’apparaissant qu’à un observateur, pas aux éléments eux-mêmes.
2) Les équations sont symétriques entre cause et effet. En bon réductionniste, Russell soutient que la causalité est invisible dans les lois d’association des éléments fondamentaux. Un élément dans une équation ne mérite pas plus le titre de cause que les autres, ce qui est gênant pour un concept intrinsèquement pourvu d’une direction de l’un vers l’autre.
3) La notion de succession a disparu de la physique. Elle est remplacée par la coexistence d’éléments au sein des équations. Le temps n’est pas implicite dans la notion de séquence mais il l’est dans celle de succession. Or les équations, en tant que séquences, sont intrinsèquement dépourvues de succession. Elle n’ont aucun caractère temporel. Elles ne “défilent” pas non plus, ni dans un sens ni dans l’autre. Le temps est seulement un paramètre qui peut leur être intégré.
Le cadavre bouge encore
Inutile alors, la causalité ? Le réductionnisme scientifique, dans la foulée de Russell, semble fort bien s’en passer. Cependant un indice me fait douter. Si la causalité est un concept sans intérêt, pourquoi débattre avec tant d’énergie de la rétro-causalité, ou causalité top-down, épouvantail des réductionnistes ? Ferait-elle de l’ombre à une causalité bottom-up toujours nécessaire en physique ? Le cadavre bouge dans le placard.
Les philosophes l’ont entendu et la causalité n’a pas été éliminée de leurs matières à penser. Elle a reçu plusieurs bouées de sauvetage successives :
1) Modèle déductif-nomologique (DN) (Hempel, Oppenheim) : l’explanandum, ce qui est expliqué (l’effet), se déduit de l’explanans, ce qui explique (la cause). Outre que ce modèle ne peut se défendre contre les objections de Russell, il souffre de nombreux contre-exemples qui lui ont fait préférer les suivants:
2) Contrefactuels (Lewis, Stalnaker) : l’événement e dépend causalement de l’événement c si les deux contrefactuels suivants sont vrais : si c avait eu lieu, e aurait eu lieu ; si c n’avait pas eu lieu, e n’aurait pas eu lieu. Les contrefactuels ont aussi leurs contre-exemples et pour Kistler c’est parce qu’ils reposent sur les mêmes fondements que le modèle DN. J’avais déjà traité les contrefactuels ici. Ma conclusion est qu’ils ne sont pas adaptés à la dimension complexe. Contextuels et non universels, il faut les garder au sein d’un niveau de réalité bien délimité.
3) Agentisme / interventionnisme (Gasking, von Wright, Cartwright, Price, Menzies, Keil) : fonde l’asymétrie de la causalité —qui pose des problèmes insurmontables aux théories précédentes— sur l’asymétrie entre le passé que nous ne pouvons pas influencer, et l’avenir qui se présente à nous, agents, comme un espace ouvert de possibilités. L’agentisme assume pleinement son anthropocentrisme, avec l’inconvénient de réduire le champ de causalité aux interventions humaines, ce qui le déconsidère comme théorie générale.
4) Probabilisme (Suppes, Papineau, Mellor, Eells) : version affaiblie de la théorie déductive-nomologique, qui substituent des lois probabilistes ou statistiques aux lois déterministes de l’explanans. Mais il est également possible d’arriver au probabilisme par l’agentisme : il est rationnel de faire A dans le but d’obtenir B ssi l’on croit que A cause B parce que la probabilité B avec A est très supérieure à B avec non-A.
5) Transmission (Reichenbach, Salmon) : le propre des processus causaux est d’avoir la capacité de transmettre un caractère, où un caractère est « le résultat d’une intervention par l’intermédiaire d’un processus irréversible ». Une objection assassine tombe immédiatement: la 2ème partie de la phrase, qui définit un caractère, est la définition de la causalité. Tandis que la 1ère partie définit la causalité à partir du caractère. Circularité évidente. Cependant la transmission peut être sauvée en précisant que le ‘caractère’ est la transmission d’une quantité conservée, présente dans la cause et l’effet, par l’exemple l’énergie. Le caractère s’affranchit alors de la cause comme de l’effet pour se définir.
Chevalier Kistler entre en scène
La solution de Kistler est ici en gestation : il fait de la causalité le transfert d’une grandeur constante entre évènements (et non objets), puis explique de manière convaincante comment cette définition simple résiste aux critiques précédentes.
Mais d’autres surgissent. La solution ne rend pas compte des mimétismes : la simple observation d’un évènement peut déclencher sa reproduction chez l’observateur, ou une action sans interaction et donc sans transfert d’une grandeur physique quelconque. Tout se passe chez l’observateur par délégation. Pourtant l’évènement correspond bien à un déclencheur causal.
Intermédiaires causaux
Kistler contourne le problème avec les “intermédiaires causaux”. Une représentation mentale est un intermédiaire causal entre les stimuli sensoriels et les actions. Cette nouvelle catégorie, les intermédiaires, m’apparaît comme une poubelle à questions chiffonnées. Que sont les “grandeurs constantes” transférées, quand elles ne sont plus quantitatives/énergétiques mais qualitatives ? La vue d’une pomme qui tombe déclenche la mise au point des équations de la gravitation. Causalité avérée mais transfert bien difficile à suivre. Kistler recourt à un empilement de propriétés émergentes, depuis les échanges neuraux physiques, pour retrouver ses grandeurs conservées. Mais s’il faut voir la causalité comme pur transfert de ces grandeurs fondamentales, cela oblige à aplatir la réalité et ses qualités. Difficile de s’en tirer sans réfléchir davantage sur la dimension complexe de la causalité.
Kistler: « Il ressort de cette analyse que l’application du concept de causalité à l’explication de phénomènes complexes, par exemple biologiques, est conditionnée à la fois par la présence d’un transfert et par l’existence d’une dépendance nomique entre certaines propriétés des événements à expliquer. »
Autrement dit, pour sauver la causalité en tant que transfert d’une grandeur constante, pour les éléments complexes, Kistler introduit une dépendance nomique (une loi) propre aux éléments en interaction. Il redonne à ces éléments la responsabilité de leur causalité interactive. La dépendance nomique reposant sur les propriétés des éléments, elle est inscrite dans leur niveau local de réalité. Il ne s’agit pas de lois naturelles universelles. La causalité redevient locale, multiple, contextuelle.
Et la causalité intentionnelle (top-down)?
Kistler tente de sauver l’universalité de sa solution en raccrochant la dépendance nomique aux grandeurs constantes. Il procède de cette manière : les propriétés sont les apparences des grandeurs conservées, dit-il. Il se base sur les corrélations réductionnistes entre propriétés complexes et constitution physique sous-jacente. Ce qui l’oblige à un parti-pris sur l’émergence. Pour que les grandeurs soient correctement conservées, il faut supposer une causalité entièrement bottom-up dans la complexité. Malheureusement sans possibilité de causalité top-down, le problème de l’intention en tant que causalité n’est pas résolu. Kistler n’aborde pas directement cette difficulté, qui demande un développement très long et n’a pas de réponse consensuelle.
C’est là où s’arrête le travail de Kistler, qui a débrouillé remarquablement l’affaire dans les limites qu’il s’est fixé.
*
Partie 2: Application de l’UniPhiM
Appliquons à présent le double regard de notre UniPhiM. Pour Russell aucune théorie de la causalité n’est ontologique. Au sens propre il a raison, puisque le regard ontologique authentique —celui du réel en soi— est inaccessible. Cependant nous utilisons à sa place le regard ascendant, pseudo-ontologique, en prêtant au réel en soi les intentions de nos théories, qu’elles soient scientifiques ou non. La théorie déductive-nomologique appartient clairement à ce regard ascendant. La causalité de Hume et l’agentisme, eux, sont propriété du regard descendant, téléologique. Quant au probabilisme il appartient aux deux regards. Comment réussit-il ce miracle ? D’une part les modèles ascendants actuels s’enracinent dans le probabilisme quantique. D’autre part le mental d’où part le regard descendant est bayésien : il met constamment à jour ses prédictions en actualisant des probabilités.
Bon, ce mérite du probabilisme est un peu forcé. En fait le modèle quantique comme le modèle bayésien du cerveau appartiennent au regard ascendant. L’expérience du regard descendant est de “savoir” qu’un effet suivra une cause. C’est une intuition —une impression— et non un calcul de probabilité, sauf chez ceux qui ont entraîné leur cerveau à faire ce calcul, à modéliser leur propre regard descendant par l’ascendant.
Réconciliation…
Nous avons donc des théories causales qui se complètent fort bien, en tant qu’outils des regards descendant et ascendant. Les difficultés que rencontre chacune en tant qu’explication ? Elles n’apparaissent que si le regard inadéquat s’en empare. L’ascendant se désole de l’imprécision de l’agentisme, qui se moque des micromécanismes ; tandis que le descendant loue son côté pragmatique, qui parvient à rendre compte de causes d’une complexité inouïe. Vive l’approximation ! Vive la probabilité qui permet d’avancer sur un chemin d’incertitudes.
Quand l’approximation est en échec, le regard descendant va quêter l’aide de l’ascendant, ancré dans les micromécanismes. L’ascendant demande en retour l’aide du descendant pour catégoriser la multitude de résultats possibles. La controverse s’éteint. Chaque regard se soutient.
…dans la différence
La différence essentielle entre ces deux regards est que l’ascendant déroule un processus causal unique, tandis que le descendant peut en inventer une multitude, selon les régularités qu’il aperçoit et les catégories qu’il leur applique. Du moins les choses sont censées se passer ainsi dans l’idéal. En pratique comme la causalité ascendante est pseudo-ontologique, plusieurs versions se succèdent pour mieux coller au réel en soi. C’est le principe des révolutions scientifiques. Un regard ascendant en remplace un autre. Néanmoins la science s’efforce de rester consensuelle à ce sujet, aidée par l’objectivité des expérimentations. La causalité ascendante peut être assimilée comme unique.
Mais dans ce cas comment faire coïncider une causalité ascendante unique et les descendantes multiples ? C’est possible avec la dimension complexe. L’UniPhiM explique que le regard ascendant voit un chemin unique et continu à travers la complexité, celui du déroulement des processus. Tandis que le regard descendant voit la discontinuité des organisations des systèmes et leurs propriétés spécifiques. Il voit des échelons de complexité bien individualisés, chacun doté de ses relations causales locales. Un grand nombre de causalités locales issues des représentations mentales.
Cela dénigre-t-il la possibilité d’un principe universel de causalité ? Jamais, à vrai dire. Je me contente de dire de quelle manière nous le cernons de notre double regard, s’il existe. Nous en reparlerons dans un instant.
Ne pas confondre le principe / la causalité et ses résultats / les causes
Pas de causalité universelle avérée, mais des causes locales donc. Ne confondons pas les causes, dont les types sont innombrables, et la causalité en tant que principe. Le principe inclue une succession temporelle, indique Russell en le jugeant ainsi déconsidéré, parce que le temps n’est qu’un paramètre des équations. Une direction est ajoutée à cette succession, de la cause vers l’effet. La causalité semble ainsi indissociable du temps, et la flèche causale de la flèche du temps. Défaut rédhibitoire pour Russell et son regard ascendant, mais avantage capital pour nos regards descendants, qui multiplient brillamment les critères pour séparer et identifier les entités réelles.
Nous arrivons directement, en effet, sur la définition la plus populaire de la causalité : c’est le nom donné à la succession temporelle des évènements, du passé vers le futur. L’effet est le présent succédant à la cause passée. Définition très universelle, trop vague pour les philosophes analytiques, mais néanmoins d’une grande efficacité. Elle se défausse de son flou sur celui qui entoure la caractérisation des entités réelles et leurs relations. Ce n’est pas le principe de causalité lui-même qui est vague —nous venons de le définir très précisément—, ce sont les sujets auxquels il fait référence. On peut se représenter la causalité du regard descendant comme devant un emboîtement de poupées russes. Chaque poupée est faite de l’ensemble des interactions apparentes entre éléments d’un système. Les poupées peuvent être plus ou moins solides, selon la qualité du modèle interactif. Mais cela n’entame en rien le principe de causalité lui-même, qui dit simplement : il existe un modèle causal expliquant le destin du système.
Dans cette vision, l’intérêt de la causalité est purement épistémique, et sa fragilité nomique également. L’utilité d’un modèle causal est corrélée à l’efficacité du modèle pour décrire l’ontologie du système. Cette utilité s’effondre quand le modèle est médiocre. Mais cela ne touche pas à l’utilité du principe, qui intègre parfaitement ces écarts de réussite.
*
Conclusion
Redonnons la parole à Kistler: « Le débat philosophique sur le concept de causalité est loin d’être achevé. Comme j’ai essayé de le montrer, toutes les tentatives pour trouver une analyse relativement simple qui réduit la causalité à la dépendance contrefactuelle, à l’augmentation de probabilité, ou à un transfert sont confrontées à des difficultés importantes. Certains répondront que, tout bien pesé, Hume, Russell et Carnap avaient raison de conclure que le concept de causalité n’a pas sa place dans l’ontologie, c’est-à-dire dans la théorie des types d’entités qui existent objectivement. Plutôt que de s’obstiner à concevoir la causalité comme relation objectivement réelle, d’une manière qui s’accorde à la fois avec nos intuitions et avec les résultats scientifiques, on ferait mieux de se rabattre sur l’étude de l’apparence causale : il n’y a pas de sens à accorder à l’idée selon laquelle la réalité est causalement structurée ; tout ce qui existe sont des représentations de causalité ; or, l’étude de telles représentations appartient au domaine de la psychologie, non de l’ontologie. Une autre conclusion que l’on pourrait être tenté de tirer de l’échec (provisoire) de ces tentatives d’analyse serait de dire qu’il n’existe aucune relation unique qui s’applique dans tous les contextes : il n’y aurait que des relations causales hétérogènes qui ne partagent aucun principe commun. Selon ce point de vue, il y aurait une causalité propre à la physique, une autre propre à la biologie, et une autre encore qui s’applique en psychologie. »
La conclusion de Kistler est d’une justesse vraiment étonnante. D’une part il se garde de fanfaronner sur la solution qu’il a proposée, dont les mérites sont pourtant incontestables : elle réussit à contourner les principaux écueils des théories antérieures. Mais Kistler est trop honnête pour ne pas reconnaître sa faiblesse en matière de sciences humaines. Devant cet échec relatif, il encourage à trouver des solutions au cas par cas, donc à abandonner l’idée d’un principe universel pour des causalités hétérogènes.
Le prêt de nos intentions au réel… qui les accepte
L’histoire n’est pas terminée, comme le soutient Kistler. Mais alors qu’il attend une issue des analyses hybrides, je pense qu’elle est déjà là, sous notre nez. Opposons la multiplicité accessible du concept ‘causalité’ vu par le regard descendant/épistémique à son inaccessibilité par le regard ascendant/pseudo-ontologique. Je m’explique :
L’utilité des causalités épistémiques n’est pas contestable. Elles permettent la mise au point de nos modèles. Pour ancrer notre intention dans le monde physique, il faut la lui prêter. C’est cela, au fond, la causalité : le prêt de notre nature intentionnelle à la réalité matérielle, peu importe si elle n’en est pas dotée. Tout se passe comme si la Nature voulait se comporter d’une certaine manière. Même les ontologues ne lui disputent pas la propriété de ses lois. Cela fonctionne donc plutôt bien.
Pragmatisme causal
Mais se dire ontologue demande de la modestie. Nos théories fondamentales sont une pseudo-ontologie, répétons-le. La réalité en soi n’est pas accessible. Affirmer qu’elle ne connaît pas de principe de causalité est d’une fatuité intenable. Au mieux peut-on dire qu’on ne voit pas trace dans les équations des intentions que nous prêtons aux choses. Mais comment pourraient-elles les montrer ? Le langage mathématique n’est pas équipé pour l’intention. Il est purement descriptif. Les équations se déroulent. Nos instruments parlent le même langage. Si les quantons ont des impressions quelconques, aucun scientifique n’a les moyens d’en rendre compte.
Nous voici au final avec:
1) un large échantillon de causalités épistémiques, riche outil du regard descendant, qu’il est possible d’organiser grâce à la dimension complexe,
2) une absence de causalité unique pour le regard ascendant, pseudo-ontologique, qui n’élimine pas un principe fondamental en soi dans cette direction.
Mais à vrai dire le regard ascendant n’a guère besoin du principe, la science se débrouille très bien sans. Conservons donc la causalité là où elle est utile, sans se tromper d’adresse : il n’est pas toujours facile en effet de la positionner correctement dans la dimension complexe. Sa fiabilité repose entièrement sur celle de notre modèle, au croisement des regards ascendant et descendant.
*
Et la suite?
Une dernière question est importante à régler : quels rapports entretiennent les concepts ‘causalité’ et ‘temps’ ? Leurs statuts ont des points communs étonnants. Téléologiques à coup sûr, il n’est pas exclu que ces concepts soient aussi ontologiques. Impossible d’interroger le réel en soi. Que les équations physiques ne requièrent pas ces principes n’est pas suffisant pour affirmer qu’ils ne sont pas ontologiques. Pour le comprendre il faut examiner ce qu’est une équation physique.
Une équation est le modèle d’une portion du réel en soi. C’est assurément un langage, avant tout autre espoir. Un langage que comprend le réel en soi. Mais c’est une fatuité anthropoïde que prétendre qu’il s’agit du réel en soi lui-même, dire par exemple que l’univers n’est fait que d’information. Nous n’avons aucun moyen de valider cette opinion, quel que soit le succès des théories fondamentales.
Les mathématiques étant un langage, il est impossible de dire ce que recouvrent réellement ses mots. À quoi correspondent les signes « + » ou « = » dans le réel en soi ? Quelles sont ces additions et ces égalités par essence ? Nos instruments sont incapables de nous le dire. Certes ils ne sont pas de simples locuteurs mathématiques comme nos esprits ; ils entrent directement en relation avec le réel en soi. Mais ce qu’ils en transcrivent à notre esprit reste de nature langagière. Dans le meilleur des cas, c’est la simple confirmation que nos mots sont justes, ou plutôt d’une approximation acceptable. La mesure n’atteint jamais l’idéal d’exactitude qui est la marque de l’équation.
Nous ne savons donc pas réellement ce que recouvre un mot aussi essentiel que « = ». Ou plutôt nous devinons qu’il recouvre plusieurs types d’équivalence. Réunir des intensités de champs en une nouvelle intensité, ou réunir les nombres d’états possibles d’un système moléculaire en chaleur, n’appartiennent pas au même type d’équivalence. Les émergences sont bien là, dissimulées dans le langage mathématique. Ceux qui donnent toujours le même sens au même mot n’en ont pas conscience. Russell lui-même s’est fait piéger en postulant que les équations physiques renferment des équivalences toujours identiques, en assimilant le langage au réel en soi. Ce n’est pas le cas, et il faut soupçonner dans ces différences la naissance des asymétries temporelles et causales.
Les équations physiques intègrent des dimensions cachées dans les sigles même de leur langage. C’est une certitude pour la dimension complexe. Celle-ci définissant des discontinuités dans la structure de la réalité, il est possible de réattribuer individuellement les notions de temps et de causalité à chaque niveau de réalité. C’est ce que la physique contemporaine admet en rendant aux éléments d’un système la propriété de leur cadre relationnel. Dans ce cadre sont inclus le temps effectif et la causalité du système.
*
Causation and Laws of Nature, Max Kistler 2003
La causalité dans la philosophie contemporaine, Max Kistler 2004, Intellectica, 2004/1, 38, pp. 139-185